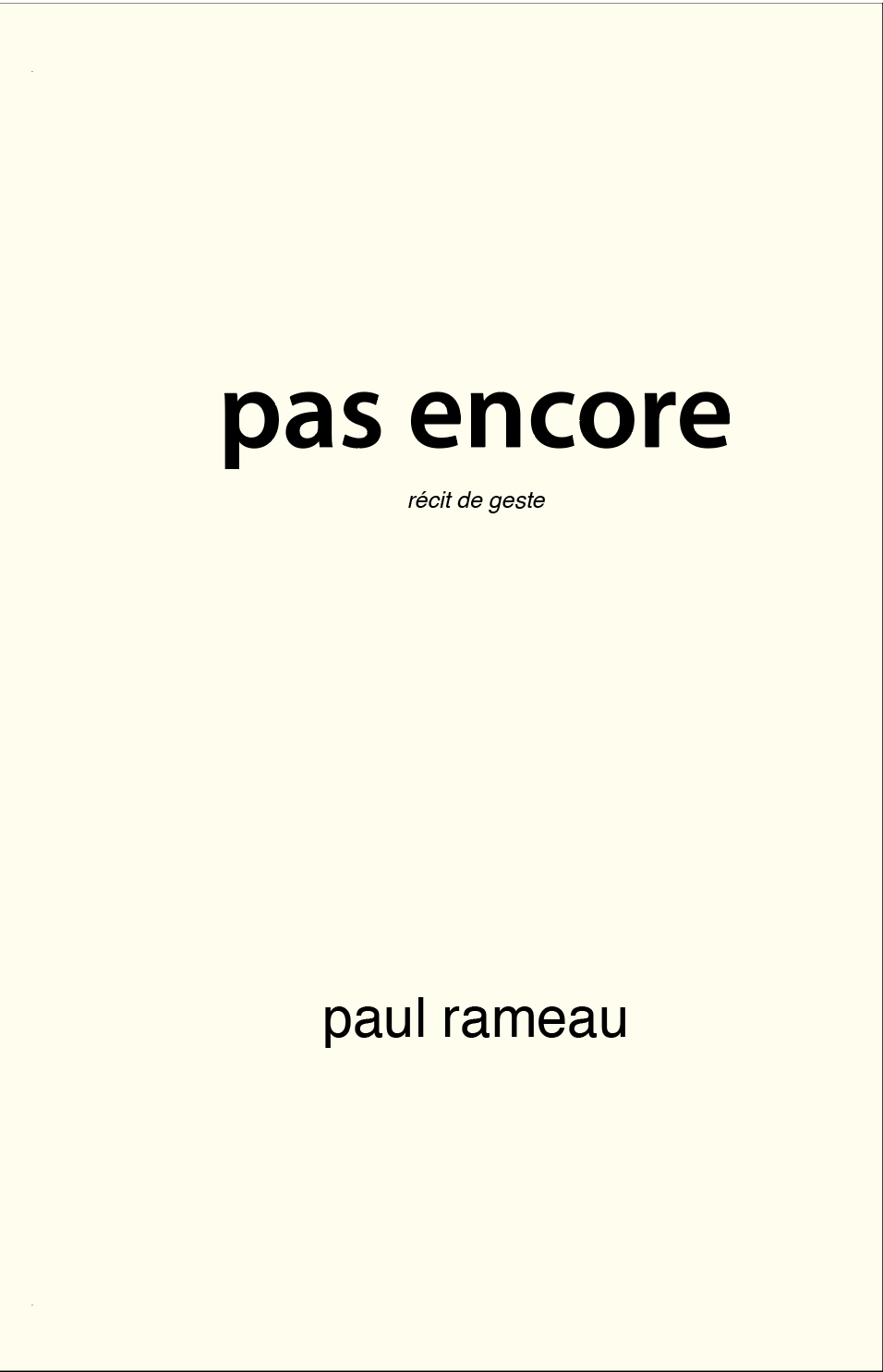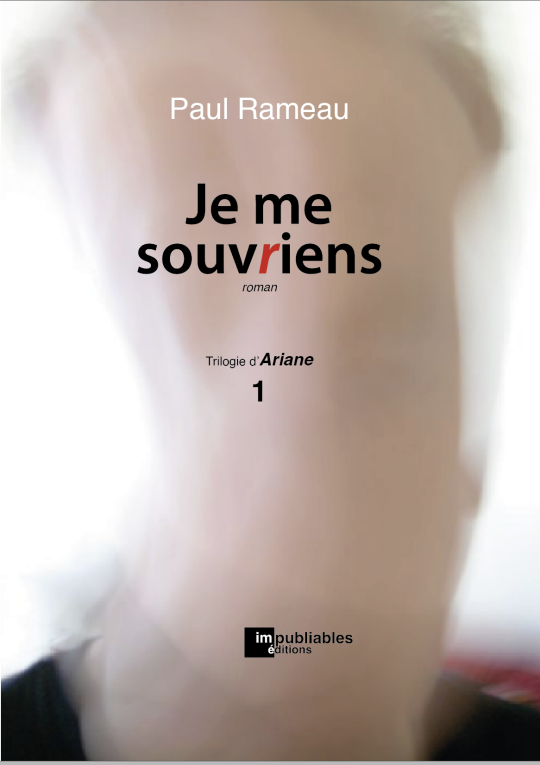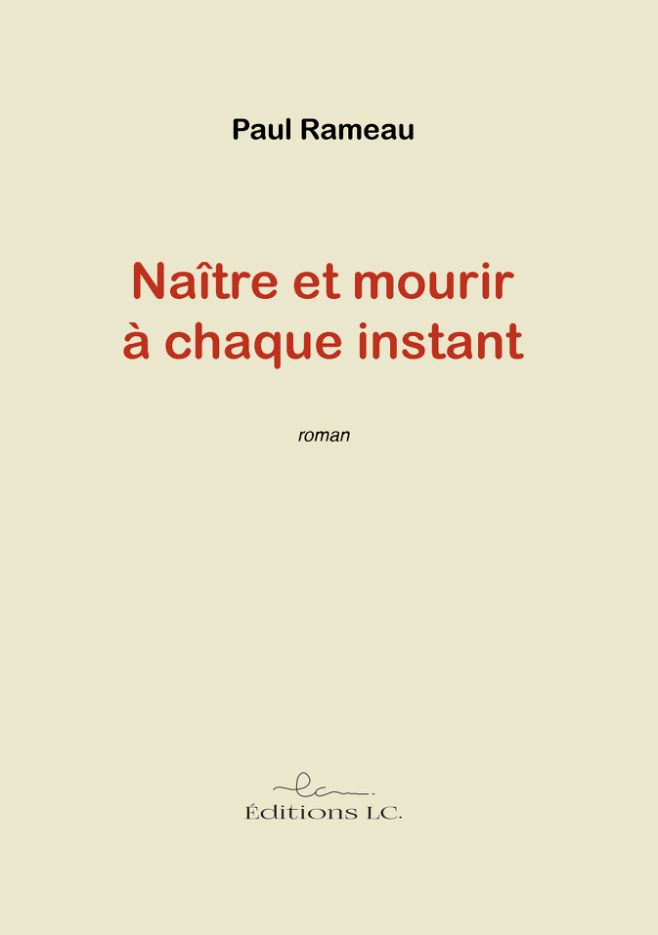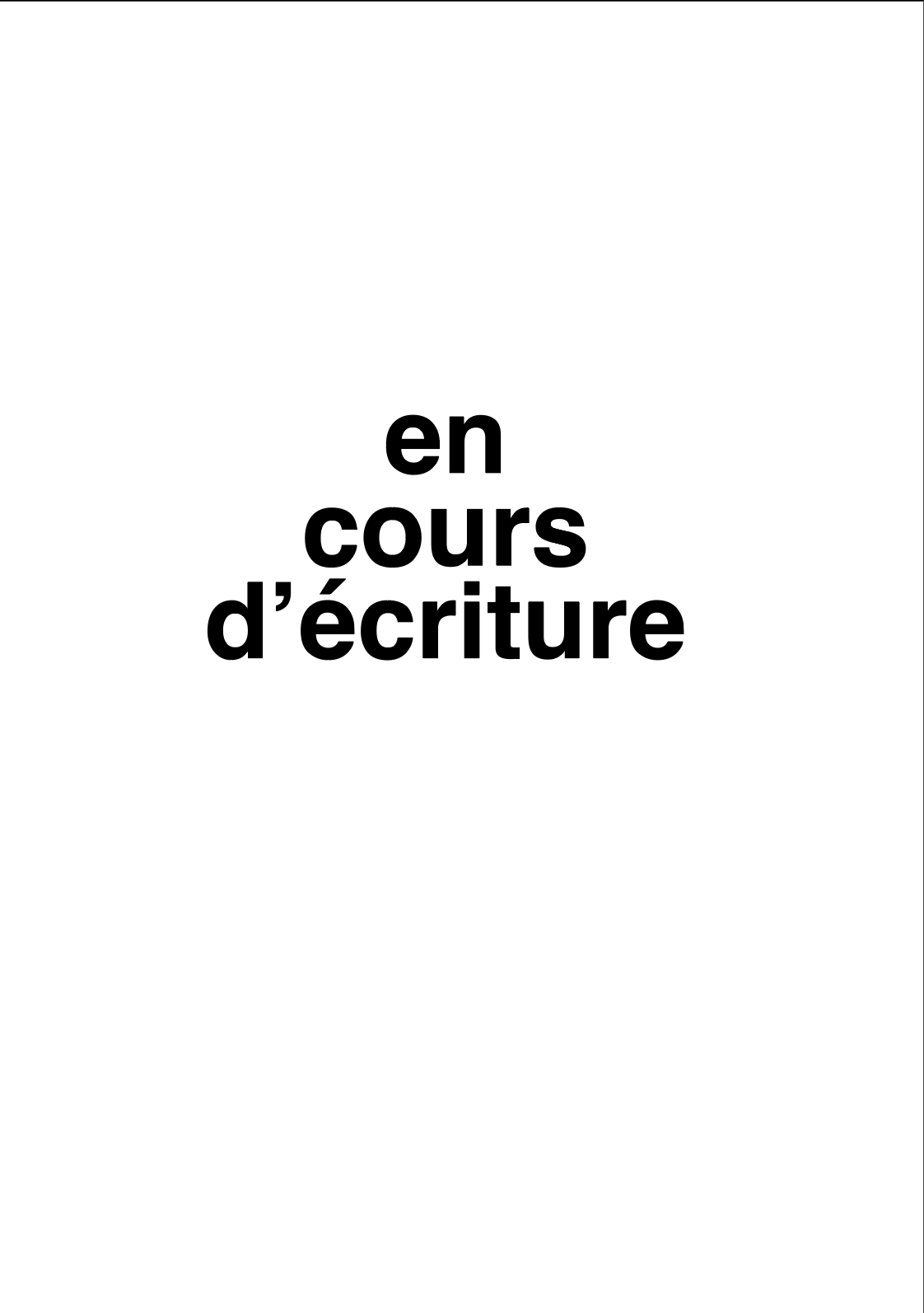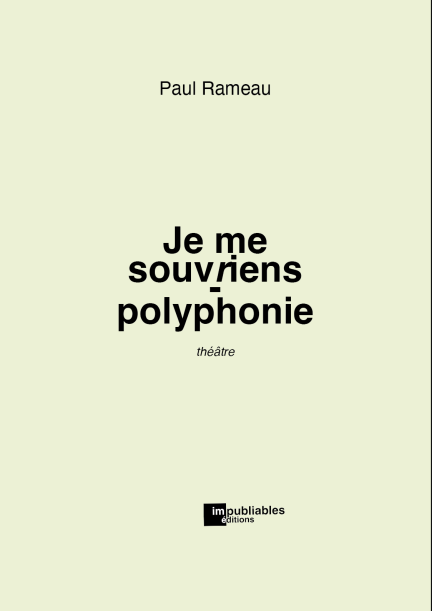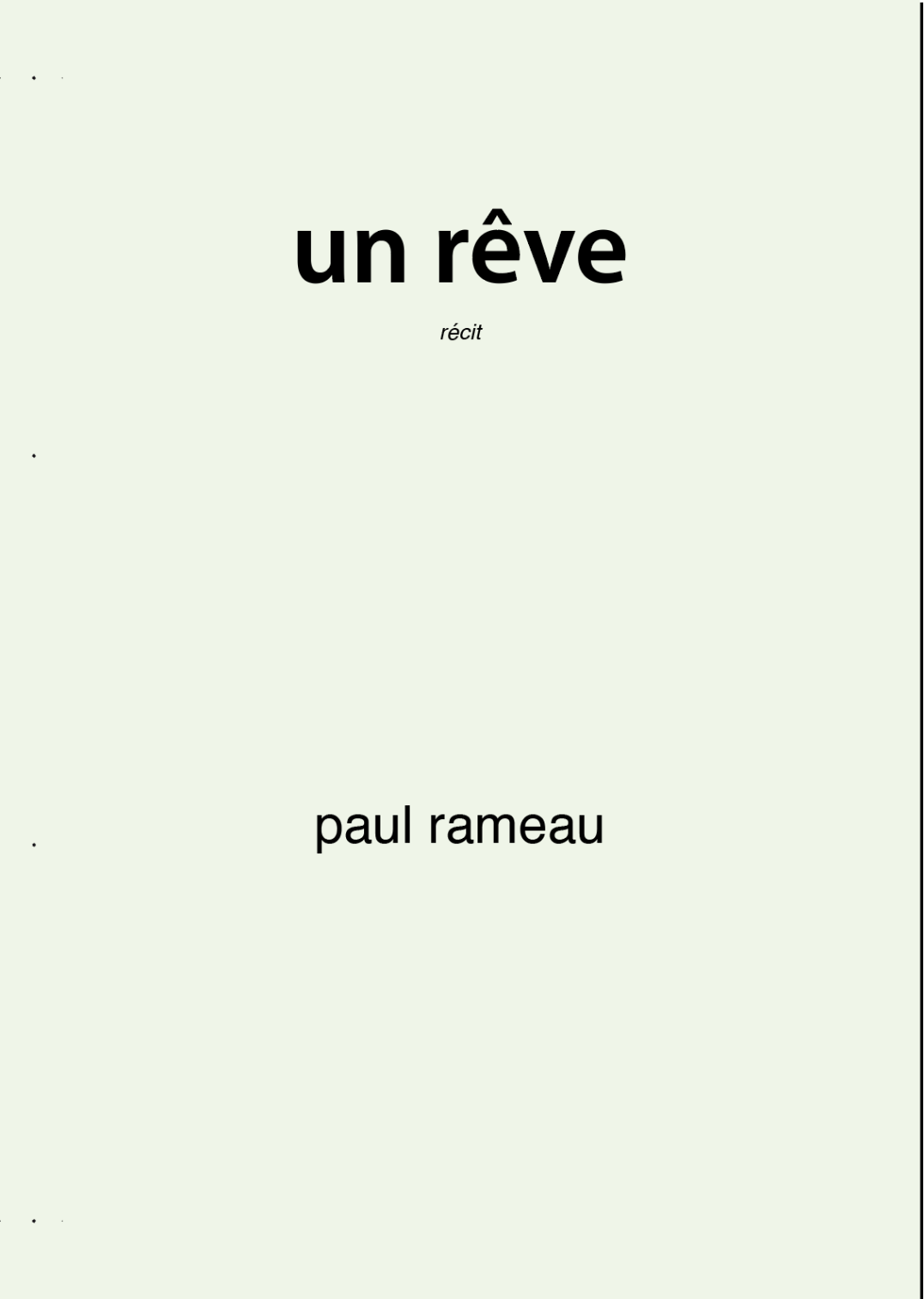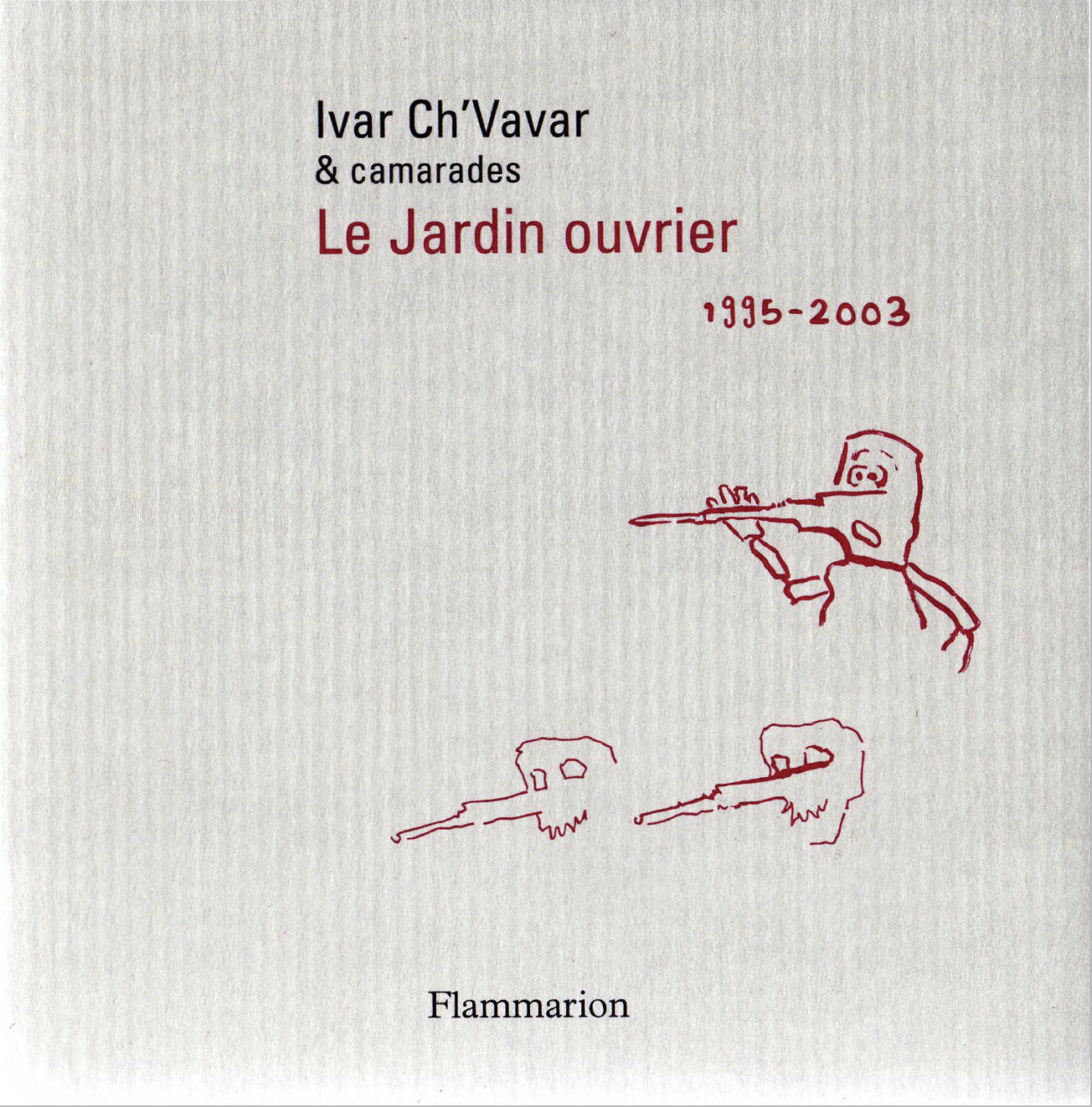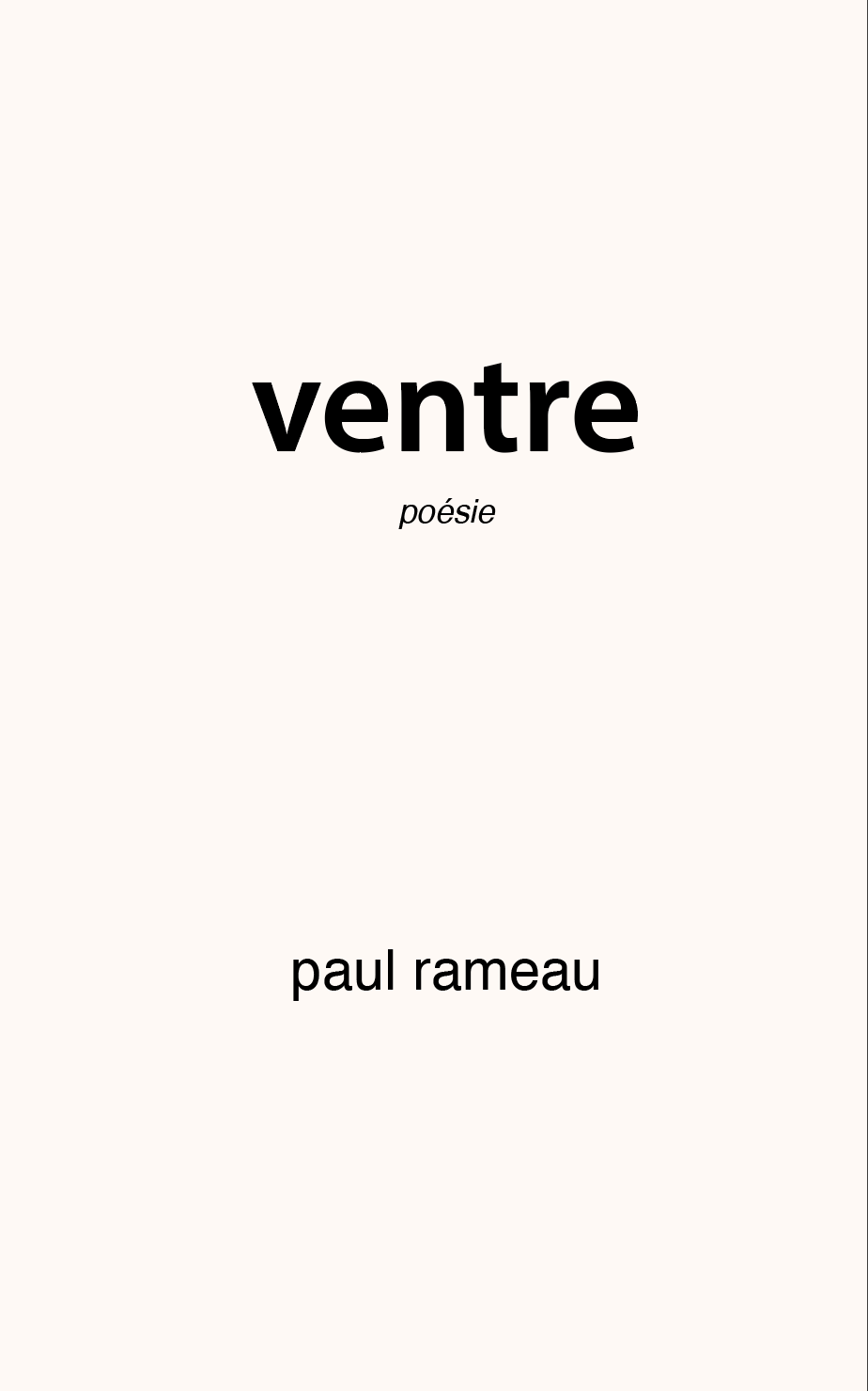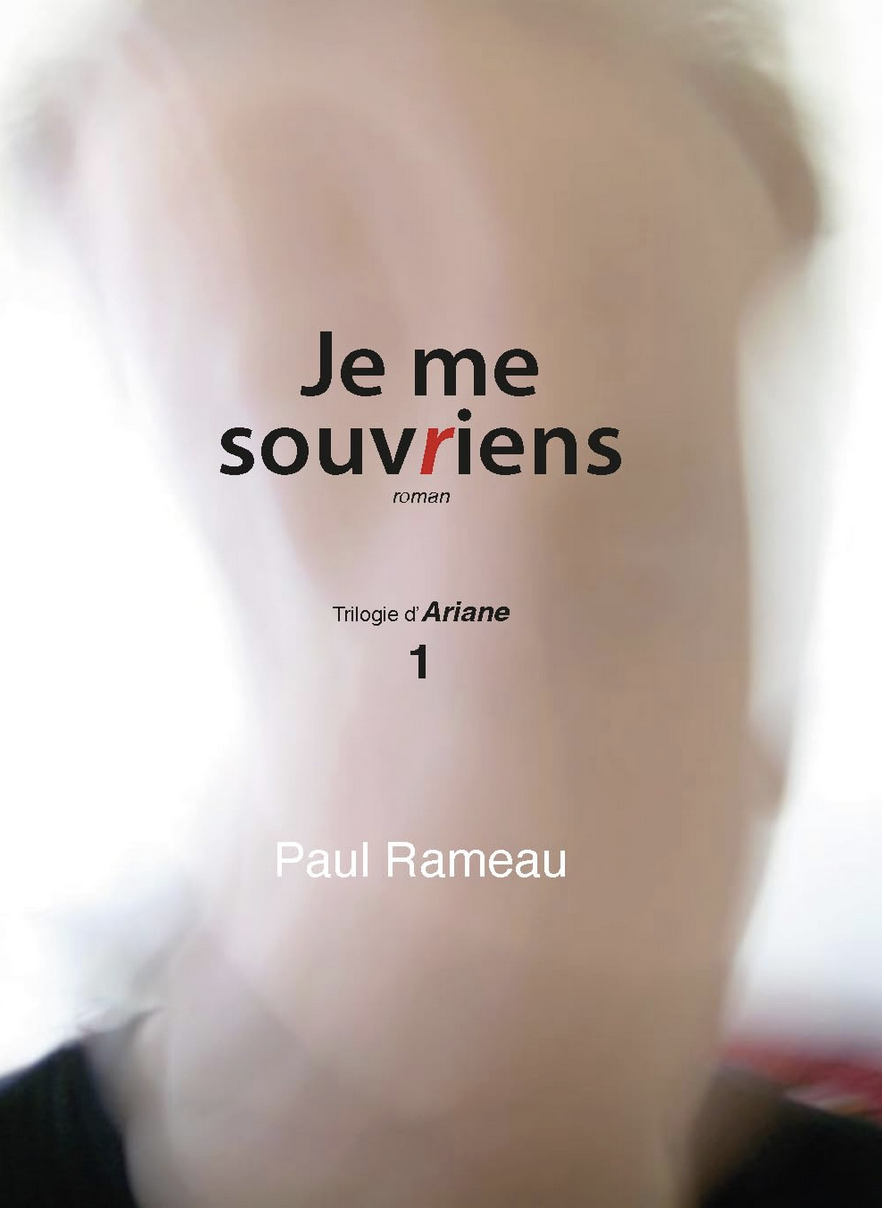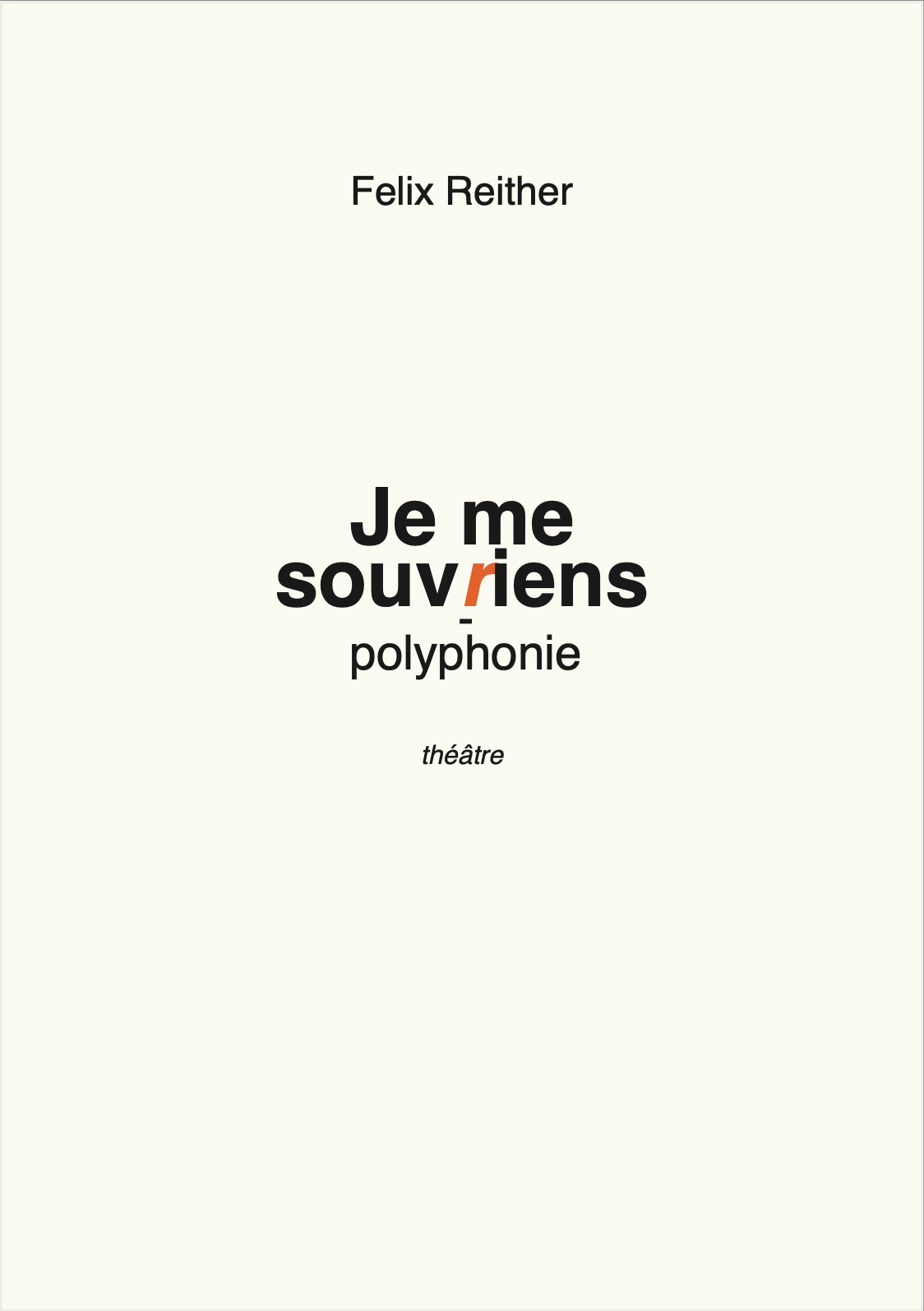Ce texte extrême et labyrinthique résulte d'une expérimentation se risquant à relater une expression poétique nourrie d'inconscient sous la forme d'un récit.
Au moyen de phrases intentionnellement polysémiques où l'absence de ponctuation permet de jouer avec les mots par d'infimes déplacements de sens, le texte se met en marche en s'appuyant sur l'ambiguité du mot "pas".
À partir de là, se déroule une fable en trois temps (assis, debout, couché) dont rien ne semble arrêter le cours. Les derniers instants de la vie d'un homme s'y dilatent :
1. Il est assis (Mais qui est-il ?) et il se voit marcher.
2. Il se lève, et sous escorte, marche jusqu'à un mur pour rejoindre d'autres comme lui.
3. Déflagration. Il tombe parmi d'autres, mais même à terre, il continue intérieurement à marcher. Ce n'est pas encore la fin. Il ne se peut que ce soit la fin…
Ayant été fortement impressionné par la visite de la Sablière à Chateaubriant, Pas encore rend implicitement hommage à vingt-sept hommes fusillés un 22 octobre 1941, et à bien d'autres encore…
Au moyen de phrases intentionnellement polysémiques où l'absence de ponctuation permet de jouer avec les mots par d'infimes déplacements de sens, le texte se met en marche en s'appuyant sur l'ambiguité du mot "pas".
À partir de là, se déroule une fable en trois temps (assis, debout, couché) dont rien ne semble arrêter le cours. Les derniers instants de la vie d'un homme s'y dilatent :
1. Il est assis (Mais qui est-il ?) et il se voit marcher.
2. Il se lève, et sous escorte, marche jusqu'à un mur pour rejoindre d'autres comme lui.
3. Déflagration. Il tombe parmi d'autres, mais même à terre, il continue intérieurement à marcher. Ce n'est pas encore la fin. Il ne se peut que ce soit la fin…
Ayant été fortement impressionné par la visite de la Sablière à Chateaubriant, Pas encore rend implicitement hommage à vingt-sept hommes fusillés un 22 octobre 1941, et à bien d'autres encore…
2012
186 p., 14 X 21 cm
Impression : 2012